En tant qu’humain, je suis rempli de paradoxes. Et jusqu’à cette interview, il y avait de nombreux paradoxes liés à l’indépendance financière et au mouvement FIRE que je n’arrivais pas à démêler par manque de connaissances. Notamment en économie, que je n’ai pas étudiée durant mon cursus scolaire.
Un exemple? Est-ce qu’on peut vouloir une croissance boursière sur le long terme sans cramer les forêts qu’on chérit tant?
Un autre? Est-ce que la décroissance ne serait pas plus alignée avec une vision frugaliste du monde?
Rencontre avec un économiste de renommée internationale
C’est au travers de divers podcasts que je suis tombé sur Jean-Pierre Danthine. Qui de mieux placé pour me répondre à ce genre de questions qu’un professeur d’économie, qui plus est ancien Président de la Paris School of Economics, ET ancien Vice-Président de la Banque Nationale Suisse?!
On pourrait se dire qu’on va s’ennuyer à mourir et ne rien comprendre en lui parlant… mais au contraire, ce qui m’a plu avec lui, c’est qu’il explique et vulgarise l’économie de façon intelligible pour le commun des mortels. Ouf!
Et surtout, ce qui m’a le plus attiré, c’est sa réussite à parler d’économie, de capitalisme, de limites planétaires, et tant d’autres choses, uniquement de façon scientifique, et jamais de manière politique!
Allons-y avec l’interview.
Présentation de Jean-Pierre Danthine
MP: “Pouvez-vous vous présenter en quelques phrases, votre parcours, et ce que vous faites ces jours?”
Je suis Jean-Pierre Danthine. À la base, je suis professeur de macroéconomie et de finance. J’ai commencé ma carrière en enseignant quelques années à Columbia University, avant de rejoindre HEC Lausanne. Au départ, j’y enseignais surtout la macroéconomie, mais mes recherches ont toujours été à l’interface entre la macro et la finance. Donc, assez naturellement, je me suis peu à peu tourné davantage vers la finance, aussi en fonction des besoins de la faculté.
Je suis resté à HEC Lausanne jusqu’à fin 2009. À ce moment-là, j’ai été nommé à la Banque Nationale Suisse (BNS). J’ai d’abord pris la tête du troisième département, puis j’ai été nommé Vice-Président, en charge du deuxième département. Cela m’a amené à faire partie du Directoire, ou de la Direction générale, ce trio de technocrates qui a la responsabilité de conduire la politique monétaire du pays. J’ai occupé ce poste jusqu’à la mi-2015.
Ensuite, je suis devenu président de l’École d’économie de Paris, une fonction que j’ai exercée pendant six ans, jusqu’en 2021 environ. Parallèlement, j’avais aussi rejoint l’École polytechnique fédérale de Lausanne, où j’ai créé et dirigé un centre qui s’appelle Enterprise for Society, ou E4S. Je l’ai dirigé jusqu’à mi-2023.
Depuis, je suis Directeur honoraire de ce centre. Mais je reste pleinement impliqué dans la réflexion sur ses objectifs, sa mission et les moyens qu’il peut mobiliser. Ce centre, qui réunit l’EPFL, l’Université de Lausanne et l’IMD, a pour but d’aider la société à réussir sa transition vers une économie plus résiliente, inclusive et durable.
Capitalisme
MP: “Quel livre recommanderiez-vous pour comprendre à la fois les aspects positifs et négatifs du capitalisme, sans aucun biais politique?”
La réponse, c’est que je n’en connais pas. Déjà, évidemment, il y a une vraie question, qui est: qu’est-ce qu’on entend par capitalisme? J’ai l’impression que, pour beaucoup de gens, ça recouvre des choses très différentes. Il n’y a pas, à ma connaissance, de définition consacrée, en tout cas pas du point de vue de la théorie économique. C’est d’ailleurs un terme qu’on n’utilise pas vraiment dans ce cadre-là.
Donc, le capitalisme… Pour certains, c’est synonyme de néolibéralisme. Pour d’autres, c’est simplement une économie de marché. Certains vont plutôt insister sur la propriété des actifs, sur la propriété individuelle. Mais moi, je n’ai pas de définition du capitalisme qui dirait que c’est forcément cela.
Je pense que, pour ma part, je dirais qu’au cœur du capitalisme, il y a bien cette notion de propriété. Mais cette propriété n’a pas besoin d’être individuelle; elle peut très bien être collective. L’idée, c’est que le propriétaire prend soin de ce qu’il possède, et que dans un monde de propriétaires, on finit tous par mieux s’en sortir.
Si on adopte une définition très large, le propriétaire peut être la collectivité, un groupe de personnes, une fondation… Ça peut prendre de nombreuses formes. Un autre angle serait de dire que le capitalisme est une forme d’organisation économique qui vise à préserver le capital — c’est un peu l’idée qu’on retrouve dans l’étymologie du terme. Et là-dessus, je suis assez d’accord.
Mais pour moi, ce capital, ce n’est pas uniquement le capital physique — les machines, les bâtiments, etc. C’est aussi le capital humain, le capital social et le capital naturel. Donc si je dis que le capitalisme est un système qui vise à préserver, voire à développer et faire croître, notre capital collectif — qu’il soit physique, humain, social ou naturel — alors oui, je me considère comme un capitaliste convaincu.
Mais je ne connais pas de livre qui expliquerait clairement les forces et les faiblesses de cette vision du capitalisme. Donc non, je n’ai pas de réponse très formelle à cette question.
MP: “Peut-on avoir un capitalisme qui ne détruit pas la planète ET qui ne nous rend pas malveillants les uns envers les autres?”
J’ai déjà un peu répondu, d’une certaine manière, en disant que ma vision du capitalisme, c’est justement celle qui cherche à maintenir le capital naturel. Et dans un monde comme celui d’aujourd’hui, où le PIB augmente, où la richesse augmente, où le capital physique croît, où le capital humain progresse — dans la mesure où l’on peut le mesurer — le capital social, lui, est plus problématique. On a un monde qui est de plus en plus polarisé, donc il y a sans doute des questions à se poser à ce niveau-là. Même si, en réalité, on ne dispose pas de mesures très claires pour l’évaluer.
Ce qu’on a comme mesures très claires, en revanche, c’est que le capital naturel, lui, est en diminution. Et là, on a un vrai problème, qui va à l’encontre, je dirais, de ma définition et de ma vision du capitalisme.
Pourquoi est-ce qu’on arrive à développer naturellement le capital physique, voire même le capital humain? Parce que là, les intérêts sont relativement bien alignés. En revanche, pour le capital naturel, ce n’est pas forcément le cas. Il y a ce qu’on appelle des externalités, ou encore ce qu’on appelle des “marchés manquants”.
Si le capitalisme repose sur l’existence de marchés pour fonctionner correctement, il faut que ces marchés existent. Or, un marché pour préserver la nature dans 50 ans, ça n’existe pas. Il n’y a pas de “marché naturel”. Donc, mécaniquement, je dirais que le capitalisme, dans ce domaine-là, doit être complété. Le marché doit être accompagné d’une intervention — pour garantir qu’on préserve aussi ce capital-là. Aujourd’hui, on n’en est pas encore là.
Est-ce que le capitalisme nous rend malveillants les uns envers les autres? C’est une question intéressante. Si on revient à Adam Smith — qui est, au fond, un des grands penseurs à l’origine de la pensée économique au XVIIIᵉ siècle — il a défendu cette idée de la main invisible, une intuition extrêmement puissante, qui a d’ailleurs été confirmée par des théorèmes très importants par la suite.
Mais dans cette vision-là, dans le cadre de la concurrence ou du marché, producteurs et consommateurs sont partenaires. Il y a une forme de coopération implicite. Et je crois qu’aujourd’hui, c’est un peu ce qui nous échappe dans un capitalisme qui a peut-être débordé de ce qu’on souhaiterait qu’il soit, et qui est peut-être insuffisamment régulé.
Ce qui est sous-jacent à pas mal de ce que je viens de dire, c’est que quand il n’y a pas de marché, il faut qu’il y ait une autre forme de régulation. Elle doit venir de la collectivité, de l’État, ou d’une autre représentation de la collectivité. Un capitalisme insuffisamment régulé peut effectivement mener à de l’antagonisme, à de la polarisation, et à ce sentiment que le système nous rend malveillants les uns envers les autres. Pour moi, c’est une perversion d’une organisation capitaliste bien comprise.
Marchés boursiers
MP: “Pourquoi dit-on que les marchés se rétablissent toujours?”
Je crois que la vraie réponse, sans entrer dans les détails, c’est que le marché suit la croissance de l’économie. Si vous prenez un indicateur comme la capitalisation boursière totale divisée par le PIB mondial, vous obtiendrez quelque chose que les statisticiens qualifieraient probablement de stationnaire.
Et puis, il y a de fortes fluctuations. Par moments, on assiste à des envolées boursières, puis à des krachs. L’économie réelle, elle, est beaucoup plus stable. Mais sur les 200 dernières années, elle a été en croissance constante. Donc, si on fait le lien, cela signifie bien que, sur le long terme, le marché suit le développement de l’économie réelle. Et tant qu’on reste dans une économie réelle en croissance, si on est suffisamment patient, on peut s’attendre à ce que le marché finisse par se rétablir.
La réalité, c’est que ce rétablissement peut parfois prendre beaucoup de temps. On a connu des périodes de 20 ans pendant lesquelles on n’a rien gagné sur les marchés boursiers. C’est arrivé. Donc, si votre patience est très grande — disons de l’ordre de 50 ans, depuis la révolution industrielle — vous pouvez effectivement dire que les marchés finissent toujours par se rétablir.
Après, ce n’est pas forcément quelque chose de très confortable pour quelqu’un de mon âge, par exemple. Mon horizon n’est peut-être pas aussi long que ça. Mais c’est quand même la réalité.
MP: “Pourquoi y a-t-il des périodes de krach (bear) et de hausse (bull)? Pouvez-vous expliquer ça comme si vous parliez à mon enfant de 15 ans?”
Je pense que le point clé, c’est que le niveau du marché dépend de ce que l’économie produit aujourd’hui, mais surtout de ce qu’on anticipe qu’elle produira à l’avenir. Et là, on entre sur un terrain d’incertitude. On forme des anticipations: est-ce que cette entreprise continuera de bien se développer dans un an, dans cinq ans? Est-ce qu’une entreprise en difficulté aujourd’hui pourra se redresser?
On se focalise donc beaucoup sur un horizon d’un, trois, cinq, voire dix ans.
Comme on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve, parfois on peut être optimiste… et parfois, beaucoup moins. Ce qui se passe, en fait, c’est que quand vous êtes dans un climat d’optimisme, vous avez tendance à rester optimiste. Et quand l’ambiance est au pessimisme, vous avez tendance à rester pessimiste.
Les marchés ont donc cette propension à traverser des phases: des phases d’optimisme, de hausse, ce qu’on appelle des phases dites “bull” en anglais. Et puis, tout à coup, c’est un peu comme un ballon… quelque chose vient le percer, et il se dégonfle. On se rend alors compte qu’on s’était tous un peu trop emballés pour quelque chose qu’on croyait fantastique… et qui, en réalité, ne l’était pas tant que ça. Voire pire, on découvre qu’il y a un événement qui change brutalement la donne.
Prenez un exemple concret: tout semblait aller bien, et puis un monsieur qui s’appelle Trump commence à prendre des décisions catastrophiques. On pensait que tout roulait, et du jour au lendemain, ce monsieur prend des décisions qui, pour tout le monde, vont au contraire créer de l’instabilité. Et donc, le marché s’effondre (“bear” en anglais).
MP: “Pourquoi dit-on que les marchés “montent toujours”? Comment peut-on en être “certain” en économie?”
Ça dépend beaucoup de la croissance de l’économie. On est quand même dans un monde où l’on commence à se poser des questions sur cette croissance fondamentale.
Ces questions sont, par exemple, liées au fait qu’aujourd’hui, si on veut vraiment regarder la réalité en face, on sent bien que le facteur de globalisation — qui était quand même lié à une certaine confiance que les uns avaient envers les autres — est en train d’évoluer.
On parlait tout à l’heure de malveillance, mais pendant longtemps, il y avait cette confiance de base: on pouvait se spécialiser, chacun dans son domaine. Ça impliquait d’accepter qu’on ne pouvait pas tout faire seul, mais qu’en travaillant ensemble, au niveau global, on obtenait un résultat bien plus efficace que si chaque pays tentait de tout faire de son côté.
Depuis les années 80-90, cette phase de globalisation a été extrêmement positive pour la croissance économique. Et aujourd’hui, on observe un retournement: pour des raisons géopolitiques, mais aussi idéologiques, on entre dans une phase de fragmentation. On détricote peu à peu des mécanismes dont on sait pourtant qu’ils ont été très favorables à la croissance.
Logiquement, cela devrait rendre la croissance moins dynamique, voire entraîner des phases de stagnation… et peut-être même de décroissance pendant un certain temps.
Et évidemment, cela aurait un impact sur les marchés, pour les raisons que j’ai évoquées précédemment.
MP: “Quel est l’impact de la prise en compte des enjeux environnementaux sur cette affirmation? (le fait que la croissance de l’économie monte toujours)”
C’est bien, parce qu’effectivement, dans la question précédente, je parlais plutôt d’une perspective à court terme, avec la déglobalisation. Si on prend un point de vue plus long terme, là on touche aux enjeux environnementaux.
On a en fait deux scénarios extrêmes — et on se situera sans doute quelque part entre les deux. Le premier, c’est celui où l’on ne fait rien: on continue comme avant. Dans ce cas, le réchauffement climatique, les catastrophes liées au climat, la perte de productivité des terres… tout cela va impacter notre capacité à générer de la croissance à l’avenir. Cela pourrait donc conduire à une stagnation, voire à une décroissance.
À l’inverse, l’autre scénario, c’est celui où l’on décide de prendre le taureau par les cornes, de s’attaquer au réchauffement, aux catastrophes climatiques, à la perte de biodiversité et à la baisse de productivité des terres. On sait que la technologie va nous aider dans cette transition… mais elle ne nous aidera pas jusqu’au bout. Pas complètement.
Ce qui veut dire que, dans certains cas, il faudra peut-être accepter de freiner un peu notre envie de consommer. Et cela pourrait avoir un impact sur la croissance mesurée — sur le PIB, en somme.

L'Étang de la Gruère <3 — si tu connais d'autres endroits comme ça en Suisse, je suis preneur! (crédits photo: j3l.ch © Gerry Nitsch)
Je vous donne un exemple concret: la mobilité, avec l’aviation. Aujourd’hui, ce secteur est en plein développement. Il est reparti, il est toujours bien là. On est même revenus au-dessus des niveaux pré-Covid. Si vous regardez les chiffres de production d’avions chez Boeing ou Airbus, c’est impressionnant. Les chiffres liés aux aéroports aussi. Sauf que tout cela est totalement incompatible avec le respect des limites planétaires.
Donc si l’on décidait vraiment de prendre le taureau par les cornes, cela impliquerait d’accepter qu’on va voler moins.
Il y a différentes manières d’y arriver. Mais si l’on prenait les bonnes décisions, on volerait moins. Cela voudrait dire que le secteur de l’aviation — Airbus, Boeing — produirait moins d’avions, génèrerait moins de salaires. Les aéroports? Même chose. Bien sûr, l’argent irait sans doute ailleurs dans l’économie. Mais tout un pan de l’économie, ce secteur-là, stagnerait, voire serait en diminution.
Je dois dire que je n’y crois pas beaucoup — malheureusement. Mais, théoriquement, on peut bien voir que l’impact pourrait être négatif sur la croissance.
Croissance de l’économie
MP: “La croissance économique implique-t-elle nécessairement une consommation matérielle? Quel est le lien entre les deux (s’il y en a un)?”
La première chose à comprendre, c’est que les chiffres de la croissance sont essentiellement liés à notre capacité à faire mieux avec les mêmes ressources. En d’autres termes, la croissance pourrait venir du fait qu’on travaille toujours plus, ou qu’on utilise toujours plus de machines pour produire ce qu’on veut produire.
C’est vrai que si l’on avait toujours plus de machines, il y aurait de la croissance — c’est ce que dit la théorie économique. Mais ce serait une absurdité. Parce que les machines, elles se déprécient. Si vous avez trop de machines, cela finit par coûter très cher à entretenir et à remplacer. C’est un peu comme avec les routes en Valais: si on en construit trop, au bout d’un moment, l’entretien devient trop coûteux. On se dit alors qu’on est allé trop loin.
C’est pareil pour l’économie en général. Si l’on a trop de machines, cela n’a plus de sens. Et à l’échelle macroéconomique, on constate que, dans les pays développés, ou dans ceux qui ont atteint un niveau de développement dit “steady state” — un certain équilibre — la croissance ne vient plus du fait d’avoir plus de choses matérielles. Elle vient du fait qu’on a de meilleures idées.
Et quand on comprend cela, on réalise aussi que la consommation, dans le PIB, est de plus en plus immatérielle. Et que l’avenir ira sans doute dans cette direction. On a déjà beaucoup d’ordinateurs — est-ce qu’on a besoin d’en avoir deux fois plus par personne? La réponse est non. On tend même vers une concentration des équipements. On est passés d’une époque où beaucoup de gens avaient deux voitures, à une époque où, pour beaucoup, cela n’a plus de sens.
Pourtant, les revenus continuent d’augmenter. Et ces revenus, on les utilise de plus en plus pour des dépenses immatérielles: culture, voyages, soins à la personne… des choses qui ne sont pas matérielles.
Donc, la réponse est non: la croissance économique n’implique pas forcément une consommation matérielle accrue. On a même sans doute atteint un point absurde dans nos pays développés, où l’on a tellement sacralisé la consommation matérielle qu’on en veut toujours plus — alors qu’on voit bien que cela n’ajoute rien à notre satisfaction, à notre bonheur. C’est un problème culturel.
D’un point de vue économique, rien ne dit qu’avoir deux iPhones vous rendra plus heureux, ou qu’il faut absolument acheter un nouvel iPhone chaque année. Cela n’a pas de sens.
Donc non, la croissance n’implique pas nécessairement plus de consommation matérielle — c’est très clair.
Maintenant, comment changer de rythme? Peut-être que votre mouvement en est une manière: se dire qu’on peut être un peu plus frugal, et réaliser qu’on ne sera pas plus malheureux pour autant. On pourrait même peut-être travailler un peu moins, ou utiliser son argent autrement. Et tout cela est parfaitement compatible avec la croissance économique. C’est même totalement compatible avec la théorie économique, qui n’a jamais dit que l’objectif était de maximiser la croissance.
MP: “Quel est votre point de vue sur la décroissance? Dit autrement, la croissance est-elle une mauvaise chose?”
C’est vrai que le mouvement de la décroissance part d’une autre vision. Ce n’est pas “qu’est-ce qu’on veut obtenir”, mais plutôt “qu’est-ce qu’on doit faire pour respecter les limites planétaires”. C’est cette idée que les ressources sont limitées. Il n’y a qu’un économiste un peu utopiste pour croire que la croissance pourrait être infinie.
Mais j’ai un peu répondu à cela: la croissance n’est pas forcément liée à des ressources matérielles. Elle vient aussi de notre capacité à faire mieux avec les mêmes ressources, ou même avec moins. Donc, l’idée que “ressources finies égale croissance impossible”, ce n’est pas forcément vrai. La vraie question, c’est: est-ce qu’on doit respecter les limites planétaires? Et là, je reviens à ce qu’on disait au début: il faut absolument préserver notre capital naturel, pour nous-mêmes et pour les générations futures.
Aujourd’hui, la technologie ne nous permet pas de le faire avec le “business as usual”. Il faut donc changer quelque chose. Il y a une vision pessimiste qui dit que la seule solution, c’est la décroissance — parce que la croissance impliquerait trop de consommation, trop de pollution. Donc si on décroît, on ira dans la bonne direction.
Je pense qu’il faut être un peu agnostique là-dessus. Pour moi, l’objectif n’est pas de décroître. L’objectif, c’est de respecter les limites planétaires. Il faut être intelligent, arrêter de consommer absurdement des biens matériels, arrêter de penser qu’il faut toujours travailler plus pour gagner davantage et consommer davantage.
Est-ce qu’on y arrivera? Je n’en sais rien. Mais ce qui est sûr, c’est que respecter les limites planétaires est un impératif. Et si on le fait intelligemment, je pense qu’on peut continuer à croître — du moins, si l’on mesure correctement cette croissance. L’objectif n’est pas de décroître. L’objectif, c’est de respecter les limites planétaires, d’être intelligent, de préserver notre niveau de bien-être, et de permettre aux générations futures de bénéficier du même niveau de bien-être. Cela me paraît évident.
L’objectif n’est pas de décroître. L’objectif, c’est de respecter les limites planétaires, d’être intelligent, de préserver notre niveau de bien-être, et de permettre aux générations futures de bénéficier du même niveau de bien-être.
Est-ce que cela nous conduira à la décroissance? Je pense que non, sur le long terme. Est-ce qu’il y aura des phases de ralentissement de la croissance? Si l’on veut vraiment être sérieux sur le respect des limites planétaires, alors oui, sans doute.
J’ai donné l’exemple de l’aviation: si on vole moins, il y aura un impact. Donc oui, il pourrait y avoir des phases où la croissance sera ralentie, voire même négative. D’ailleurs, même aujourd’hui, la croissance est parfois négative — donc a fortiori, ce pourrait être le cas aussi dans ce contexte.
Performance et diversification en investissement
MP: “Peut-on encore tabler sur une performance annualisée moyenne de +7% pour un ETF Monde tout en respectant les limites planétaires? Pourquoi? Et si ce n’est pas le cas, quel rendement (%) peut-on espérer?”
Ce que je viens de dire juste avant implique que je n’aurai pas de réponse très précise à donner. Je pense que si l’on pouvait tabler sur une performance moyenne de 7%, comme on l’a vu ces dernières années, ce ne serait sans doute pas bon signe. Cela voudrait dire qu’on ne fait pas ce qu’il faut pour respecter les limites planétaires. Parce que, justement, respecter ces limites devrait impliquer, dans certains domaines, un ralentissement.
Pourquoi? Parce que la technologie dont on aurait besoin n’est pas encore disponible. Voilà. Mais il est aussi possible qu’on ne fasse rien, et qu’on continue, pendant un certain temps, à avoir ce type de rendements.
Et alors, qu’est-ce qui va se passer? On aura du réchauffement climatique, des catastrophes, de grands mouvements de population, des terres de moins en moins productives. Tout cela ne pourra qu’entraîner, à terme, des rendements plus faibles.
Donc je dirais qu’on est dans un monde où on est face à une bifurcation. Qu’on aille à gauche ou à droite, sur le moyen terme, je ne miserais pas sur des rendements comparables à ceux qu’on a connus sur les 30 dernières années, par exemple.
Maintenant, quel chiffre donner? Je n’en sais rien. Parce que cela va justement dépendre de notre capacité à être intelligents dans la façon dont on gère tout cela.
Ce n’est pas seulement une question de technologie. Oui, il y a de l’innovation technologique qui peut nous aider, mais il y a aussi la façon dont on gouverne tout ça, la gestion humaine, la gouvernance générale. Et là, on peut soit le faire de manière bête, soit essayer de le faire de manière un peu plus intelligente.
MP: “Pour un Suisse moyen, je recommande d’investir dans un ETF Monde pour être le plus diversifié possible (réduction du risque) tout en obtenant la meilleure performance possible.
Quel est votre point de vue d’économiste sur un tel portefeuille, en incluant les enjeux environnementaux?”
Mon point de vue d’économiste — et plus précisément de professeur de finance — c’est très clair: la diversification maximale, c’est la seule chose qu’un investisseur individuel peut réellement faire.
La diversification maximale, c’est la seule chose qu’un investisseur individuel peut réellement faire.
Ne pas essayer de faire du market timing, ne pas essayer de faire du stock-picking. La diversification maximale, c’est vraiment le bon point de départ. C’est la stratégie de base sur laquelle on devrait s’appuyer.
Investissements ESG, bien ou pas?
MP: “Les ETF ESG sont-ils un bon véhicule d’investissement (d’un point de vue économique)?”
Oui… j’aimerais bien vous répondre oui, mais aujourd’hui, en fait, on n’est pas très convaincu de la manière dont les ETF ESG ont été implémentés. Donc j’ai un peu de peine à vous dire qu’il faut absolument privilégier les ETF ESG plutôt qu’un ETF Monde.
Je pense que, notamment si vous avez une sensibilité environnementale, il serait peut-être plus judicieux de constituer un ETF Monde pour, disons, trois quarts de votre portefeuille. Et sur les 25% restants, cibler des investissements qui vont vraiment avoir un impact positif sur la transition vers une nouvelle forme d’économie. Mais ce n’est pas évident à faire, je dois l’admettre. Et je trouve que, de ce point de vue là, les intermédiaires — qui devraient justement aider des investisseurs comme vous et moi — n’en font pas encore assez.
C’est un peu un cercle vicieux: ces intermédiaires disent qu’ils ne proposent pas plus d’options parce qu’il n’y a pas encore assez de demande. Et de leur côté, ils ont aussi un devoir fiduciaire: leur objectif reste de répondre aux attentes de leurs clients, qui aujourd’hui privilégient avant tout le rendement. Beaucoup de gens seraient prêts à investir de manière plus durable… à condition qu’on leur garantisse que cela ne nuira pas à leur rendement. Et aujourd’hui, c’est très difficile de le garantir, pour des raisons évidentes.
Le monde évolue. On l’a bien vu: un certain nombre d’ETF ESG ont par exemple exclu les secteurs du pétrole et des énergies fossiles. Mais lorsque le prix des énergies fossiles a fortement remonté, ces ETF se sont retrouvés en difficulté vis-à-vis de leurs clients. Même chose avec l’industrie de l’armement, par exemple.
Donc ce n’est pas du tout évident. Et je pense que les intermédiaires n’ont pas encore trouvé de solution vraiment convaincante, qui permettrait à des investisseurs qui n’ont pas envie d’y passer tout leur temps, de faire des choix qui ont vraiment du sens.
Cela dit, il y a quand même une question qu’on peut se poser. On est aujourd’hui dans un monde extrêmement incertain. Et la question, c’est: autant la stratégie que vous défendez — être 100% investi et oublier ensuite — a été très valable dans le passé, autant aujourd’hui, on peut se demander si on n’est pas face à un véritable changement de paradigme. Ce qui mériterait peut-être d’avoir une petite poche d’investissement beaucoup plus sûre, de côté, au cas où les choses tourneraient vraiment mal.
Et là, je n’ai pas de réponse toute faite. C’est une question très difficile. Parce que le problème auquel on est confrontés aujourd’hui, en tant qu’investisseurs lucides, c’est qu’il y a des risques énormes… qui pourraient très bien ne jamais se matérialiser. Ce qu’on appelle des risques à basse fréquence.
Et ces risques-là, comment s’en protéger? Le problème, c’est que si vous essayez de vous en protéger, et qu’ils ne se matérialisent pas, vous serez perdant. Et vous pourriez l’être pendant très longtemps, justement parce que ce sont des risques rares.
Je crois donc que c’est une question qu’on doit avoir quelque part en arrière-plan. Et cela peut amener à se dire que certaines recommandations qui étaient très pertinentes dans le passé — et qui ont bien fonctionné jusque-là — pourraient ne pas fonctionner aussi bien à l’avenir.
Stratégie de désinvestissement?
MP: “La stratégie de désinvestissement (exclusion de certaines industries/entreprises) est-elle efficace pour soutenir les objectifs environnementaux, en tant qu’investisseur privé?”
La réponse est non. En fait, on a très peu d’exemples où une stratégie de désinvestissement s’est révélée réellement efficace.
Si, derrière cette stratégie, il y a l’idée qu’on va “fermer le robinet”, que lorsqu’on investit on donne de l’argent à une entreprise pour qu’elle fasse des choses qu’on n’aime pas, et qu’en arrêtant d’investir, on va l’empêcher de continuer… eh bien, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça.
Parce que quand vous vendez, il y a forcément quelqu’un d’autre qui achète. Et même si, dans les cas extrêmes, une entreprise devait se retrouver limitée dans ses financements via le marché boursier, elle aurait encore accès à d’autres sources: les marchés privés, les marchés obligataires, les prêts bancaires. Il y a énormément d’alternatives.
Pour qu’une telle stratégie ait un réel impact, il faudrait que tous les investisseurs soient d’accord. Mais ça, c’est totalement illusoire.
La réalité, c’est que ce qu’on observe, c’est que les stratégies de désinvestissement permettent surtout de se donner bonne conscience. On se sent mieux en les appliquant, mais elles ne sont pas efficaces en soi. Et souvent, elles conduisent à des portefeuilles déséquilibrés, avec une prise de risque différente de celle qu’on aurait normalement.
Les stratégies de désinvestissement permettent surtout de se donner bonne conscience. Elles ne sont pas efficaces en soi.
Ce n’est donc pas la bonne manière d’agir. La meilleure approche serait plutôt de rejoindre un club d’investisseurs qui agit concrètement: en participant aux conseils d’administration, en intervenant lors des assemblées générales, en pesant sur la stratégie de l’entreprise pour l’orienter dans une autre direction.
Ça, un investisseur individuel ne peut pas le faire seul. Cela doit se faire de manière collective.
Éducation financière et problèmes environnementaux
MP: “Comment l’éducation en finances personnelles (budget, épargne, investissement, etc.) peut-elle aider à résoudre les problèmes environnementaux?”
Je pense que c’est important qu’il y ait un minimum d’éducation financière. Notamment, cette idée fondamentale de diversification en matière de placement est absolument essentielle. Elle s’inscrit dans une forme d’humilité : on sait si peu de choses qu’il faut accepter de se diversifier.
Et cela demande un certain niveau d’éducation, surtout face à certaines arnaques ou publicités qu’on peut voir. On voit régulièrement des gens qui ont mis tous leurs œufs dans le même panier — un panier souvent proposé par quelqu’un qui n’est pas forcément honnête, ni même compétent, mais qui sait très bien s’exprimer. Éviter ce genre de situations, c’est évidemment crucial pour sa santé financière.
Si on a mal géré ses finances, c’est la fin du mois qui va primer. Mais si on a bien géré ses affaires, on est peut-être en position de penser davantage à ces enjeux globaux — y compris à la fin du monde.
Et puis, une fois qu’on a construit une situation financière plus saine, on est sans doute plus en mesure de s’ouvrir à d’autres enjeux, comme les problèmes environnementaux — au-delà de la simple survie financière.
On dit souvent qu’il y a un conflit entre “la fin du monde” et “la fin du mois”. Si on a mal géré ses finances, c’est la fin du mois qui va primer. Mais si on a bien géré ses affaires, on est peut-être en position de penser davantage à ces enjeux globaux — y compris à la fin du monde.
Frugalité vs croissance (pour atteindre l’indépendance financière)
MP: “Que pensez-vous du paradoxe de l’indépendance financière (FI) qui encourage une consommation réfléchie (pas d’accumulation matérielle inutile, frugalité et recherche d’une vie plus heureuse et plus riche) tout en reposant sur le capitalisme et le marché boursier pour financer une vie libre (= ne pas devoir travailler pour l’argent, et non “ne pas travailler / ne rien faire sur plage”) — où la croissance est nécessaire?”
Je crois que la croissance est utile, bien sûr, elle facilite les choses.
Mais on peut très bien s’organiser, avec un niveau de vie comme celui qu’on a en Suisse, en ayant une croissance minimale. On est d’ailleurs déjà un peu dans cette situation. La croissance par habitant en Suisse n’est pas très élevée, si on la compare aux 5, 7 ou 8% qu’on a pu observer en Chine, qui reste un pays en développement.
Je pense que le point important, c’est qu’on peut organiser une économie — une économie capitaliste, basée sur le marché, avec un fonctionnement boursier — qui soit tout à fait compatible avec une croissance modeste. Et ce n’est absolument pas incompatible avec une consommation plus réfléchie, avec de la frugalité.
Ce serait peut-être une économie un peu différente de celle qu’on connaît aujourd’hui, mais c’est tout à fait faisable.
Encore une fois, je fais la distinction entre la vision courante qu’on a du capitalisme — qui est souvent mal comprise — et la vision que je propose, qui est beaucoup plus proche de la théorie économique. Et qui dit que la croissance n’est pas un but en soi. C’est un moyen, un rêve, un résultat de notre imagination, de notre capacité à faire mieux.
Mais ce n’est pas un but en soi. Le but, c’est précisément de vivre une vie plus heureuse, plus riche.
MP: “Le revenu passif (revenu de la rente) issu de ses investissements (un des piliers du mouvement FIRE) est-il incompatible avec les défis environnementaux à relever?”
Revenu passif… vous voulez dire revenu de rente, comme on dirait? C’est ça? Plutôt qu’un revenu du travail?
Oui. Alors non, je pense que ce n’est pas incompatible. Maintenant, c’est vrai que tout le monde ne peut pas vivre d’un revenu de rente. Il faut bien qu’il y ait des gens qui travaillent. Et je pense que c’est un point important, parce que dans une société confortable comme la nôtre, on a peut-être un peu trop tendance à croire que l’argent tombe des arbres, qu’il suffit de se servir.
Non. Il y a des gens qui doivent travailler. La valeur doit être créée. Elle ne pousse pas sur les arbres. Donc je crois qu’il faut garder un certain équilibre. Imaginer pouvoir vivre uniquement d’un revenu passif toute sa vie, cela revient à dépendre du travail des générations précédentes. C’est très bien d’en bénéficier, mais ce n’est pas durable à grande échelle.
Je pense qu’autant que possible, chacun devrait apporter sa contribution à cet effort collectif qu’est la création de valeur pour la société. Alors bien sûr, chacun a ses propres dispositions, ses compétences, ses caractéristiques. Mais contribuer, cela peut aussi passer par le fait de mettre du capital à disposition, parce qu’on a été particulièrement frugal par exemple. Mettre du capital à disposition, c’est aussi une forme de contribution. Donc il n’y a pas que le travail, il y a aussi le capital, les moyens financiers.
Mais je pense qu’on est arrivé dans une période où l’on considère peut-être un peu trop facilement que tout va continuer à bien se passer, même si l’on ne contribue pas. On est devenus un peu complaisants avec cette idée. Et je pense qu’on entre dans une phase où cela va sans doute être remis en question.
On se dit parfois qu’il suffira de taxer les riches et que cela réglera le problème. Mais ce n’est pas vrai. Il faut une création de valeur continue. Et dans un monde aujourd’hui un peu moins coopératif qu’avant, certains atouts dont nous avons bénéficié par le passé ne sont plus là. Cela devrait nous inciter à être un peu plus proactifs, à nous assurer que chacun apporte sa contribution à cet effort collectif.
Notes MP
Je suis matérialiste ET capitaliste!
Lorsque j’avais vu le film “Minimalisme” (disponible en français sur Netflix), le commentaire de l’économiste Juliet Schor m’avait interpellé:
On est trop matérialistes dans le sens quotidien du terme, et pas assez dans le vrai sens du mot. On doit être de vrais matérialistes, c’est-à-dire de vraiment se soucier de la matérialité des biens.
Depuis, je me considère comme matérialiste. C’est provocant, et ça déclenche d’intéressantes conversations dans mon entourage.
Après ma discussion avec Jean-Pierre Danthine, je peux maintenant rajouter à cette déclaration: “je suis matérialiste ET capitaliste”.
Parce que si on veut que notre économie soit pérenne sur plusieurs centaines d’années, il faut que chaque propriétaire d’entreprise (incluant ses terrains, et son usage des ressources naturelles) chérisse et prenne soin de ses capitaux.
Ce qui se marie très bien avec mon approche frugale de la vie, où tu fais des achats conscients et de qualité. Des achats de biens matériels ou immatériels (car même l’immatériel a aussi un impact sur la nature) faits pour durer.
Bye bye Temu et Shein, et bonjour mode de vie frugal!
Et tout ce raisonnement n’est pas antinomique avec la croissance économique et l’augmentation du bonheur des gens, bien au contraire! Je crois que je vais continuer le blog un bon bout d’temps moi (non non, je n’en doutais pas, mais cette piqûre de rappel avec une perspective globale est la bienvenue).
Tu connais un bon livre sur le capitalisme?
J’ai du mal à croire qu’il n’existe pas un bon livre sur la capitalisme, sans que ça parte en politique dès la préface… bon, je n’ai pas beaucoup cherché moi-même, je comptais sur Jean-Pierre ;)
Quoi qu’il arrive, si tu as un tel ouvrage en réserve, contacte-moi par email ou via les commentaires avec plaisir!
Producteurs et consommateurs sont partenaires!
En parlant de perspective globale, j’ai beaucoup aimé la partie où Jean-Pierre parle des relations économiques.
Tout business devrait ajouter de la vraie valeur, comme s’il était partenaire de ses consommateurs, et non pas un extracteur souhaitant maximiser ses profits sans trop réfléchir aux conséquences (éthiques, environnementales, d’intégrité, etc.), en mode je t’enfume et tchô bonne je disparais.
Je pense ici notamment aux vendeurs de pub comme Meta, aux Tiktok, et autres Temu et Shein de nouveau.
Si je prends l’exemple du blog, ça résonne avec ma stratégie long terme vs. d’accepter les demandes de placements de pub ou de liens pourris que je reçois chaque jour… et pourtant y’aurait une pétée de cash à se faire, et je peux te dire que je serais déjà financièrement indépendant. Enfin, non, pas vraiment. Car je pense que je n’aurais plus vraiment de lecteurs, et qu’une telle approche court-termiste aurait fait couler mon blog depuis longtemps.
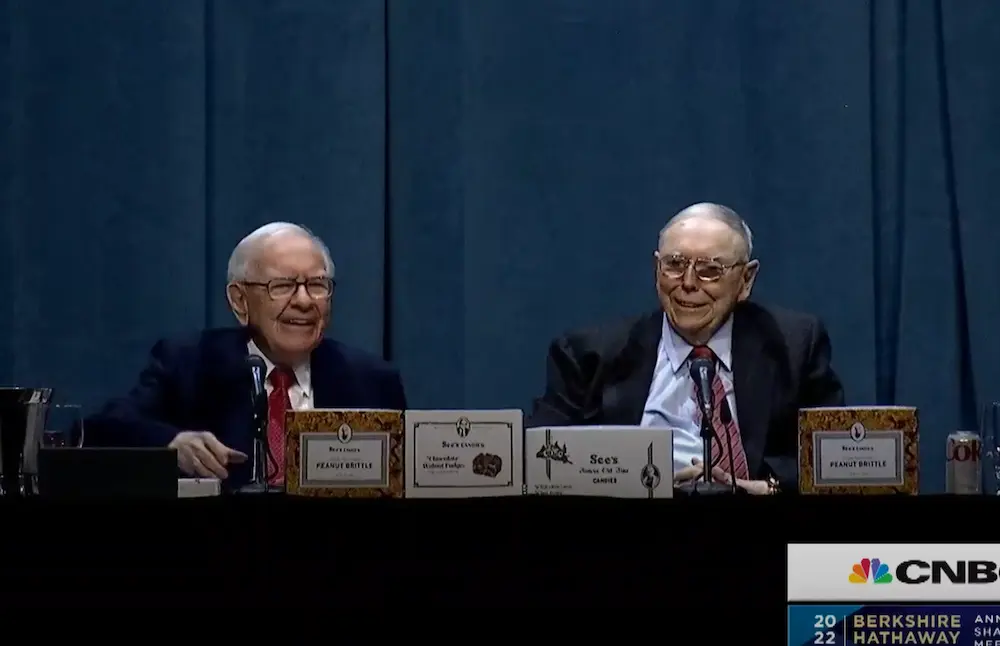
Deux compères qui ont compris beaucoup de choses simples ET terriblement efficaces quand appliquées sur le long terme et à tous les niveaux personnels et professionnels (crédits photo: CNBC Television)
Un autre exemple est mon premier club deal immobilier que je suis en train de mettre en place. Un des principes fondateurs est d’aligner au maximum mes propres intérêts avec ceux des intérêts des investisseurs. Je n’invente rien, je reprends seulement les préceptes de mentors tels Warren Buffett (investir son propre argent aux côtés des actionnaires en mode “skin in the game”), Charlie Munger (“montre-moi les incitations et je te montrerai le résultat.”), et Jack Bogle (Vanguard ne cherche pas à maximiser ses profits, mais à réduire les coûts pour ses investisseurs, car ils sont les propriétaires de la société). Ça se caractérise donc simplement par aucuns frais de gestion inutiles, et une mise au moins aussi grande que chaque investisseur.
Les marchés vont toujours vers le haut
Je te recommande la lecture de cet article si tu veux avoir une autre perspective sur le sujet.
Ah, et un petit rappel nécessaire: les marchés montent toujours pour l’investisseur indiciel (comme avec l’ETF VT), pas pour l’investisseur en mode “stock picking”. En effet, un ETF VT profite d’un auto-nettoyage automatique grâce à son système indiciel intrinsèque: les entreprises en faillite ou en déclin sont sorties de l’indice, remplacées par des plus performantes.
Croissance et limites planétaires
Je suis d’accord avec M. Danthine lorsqu’il dit que l’argent non dépensé dans du matériel irait ailleurs dans l’économie, et que la croissance ne s’arrêterait pas.
Je suis plus optimiste que lui (à tort ou à raison, l’avenir nous le dira). Que ce soit la nature ou une loi ou un nouveau système de marché environnemental, le comportement humain s’adapte en cas de contraintes. On l’a bien vu pendant le COVID.
Si demain on ne devait plus pouvoir prendre l’avion, je ne suis pas sûr que le ralentissement de croissance serait autant énorme que ça. Il serait surtout transféré. Les privés chercheront et trouveront d’autres moyens d’avoir des loisirs. Idem pour les voyages business; les sociétés auront plus de trésorerie pour réinvestir dans des choses plus utiles que des voyages d’affaires qui pourraient se faire via Zoom.
De nouveau, ce n’est qu’une hypothèse (d’un optimiste) parmi tant d’autres. L’avenir nous dira qui a raison. Et comme d’habitude, on sera certainement entre les deux.
Décroissance, pas forcément une solution
Sans politique ni dogmatisme, j’ai adoré cette phrase: “Il faut être un peu agnostique là-dessus. L’objectif n’est pas de décroître. L’objectif, c’est de respecter les limites planétaires. Il faut être intelligent, arrêter de consommer absurdement des biens matériels, arrêter de penser qu’il faut toujours travailler plus pour gagner plus et consommer plus.”
Évident? Il fallait encore avoir le bagage intellectuel pour l’expliquer de façon aussi concise.
Rendement de 7-8%?
Je suis peut-être trop optimiste (ou moins armé de connaissances en macro-économiques), ou je suis peut-être plus jeune avec encore trop d’idéalisme, mais je ne pense pas forcément que la croissance va autant baisser que ce que Jean-Pierre Danthine présage.
Ma vision tend plutôt vers une redirection de la richesse vers plus d’immatériel, quand la majorité de la population se rendra compte (forcée par la nature qui reprend ses droits ou quelconques autres lois environnementales forçant le changement de comportement) que la surconsommation n’est pas saine ni souhaitée pour quelconque humain, et qu’il y a d’autres manières d’être heureux — sur le long terme (et non pas à coup de shot de dopamine en scrollant à l’infini!) Des manières plus pérennes. Et ces choses-là généreront de la croissance économique.
Juste pour être clair: non, ça ne sera pas facile de garder une certaine croissance en respectant les Accords de Paris. Mais si on réalloue le capital intelligemment et qu’on mise sur la transition verte comme moteur d’innovation, alors rien n’empêche que cette croissance reste solide, voire même qu’elle en ressorte renforcée à long terme.
On en reparle dans 50 ans!
Diversification, diversification, et diversification (de tes investissements)
S’il te fallait encore une preuve “officielle” d’un “vrai” économiste (vs. un blogueur suisse aléatoire) pour te confirmer tout ce que je raconte dans:
- cet article sur comment j’investirais CHF 10'000 si je recommençais de zéro aujourd’hui
- mon livre
- ou encore mon programme qui te permet de te lancer en bourse en quelques semaines en comprenant ce que tu fais
… alors, la voici par un vrai économiste officiel: “La diversification maximale, c’est la seule chose qu’un investisseur individuel peut réellement faire.”
ESG et désinvestissement, oui… mais non!
Je comprends l’intention derrière l’ESG et le désinvestissement. Mais perso, je préfère rester investi dans toutes les entreprises au niveau mondial, à travers un portefeuille bien diversifié (ou devrais-je dire à travers le seul et l’unique: l’ETF VT). Et utiliser mon temps pour créer un vrai impact. Ce blog en est un exemple. D’autres, une fois FIRE, choisissent de bosser dans des boîtes durables. Et les plus courageux (ou les moins flippés?) se lancent dans l’entrepreneuriat à impact à pieds joints.
Ma conscience, elle râle un peu parfois, mais elle s’en remet. Je veux agir là où c’est prouvé que ça marche. Pas juste faire ce que la majorité fait pour se donner bonne conscience… alors qu’au final, ça change que dalle. Nada.
Si tu veux plus de détails à ce sujet, je te recommande cet article toujours valide à ce jour.
Conflit entre fin du monde et fin du mois!
Cette citation a beaucoup raisonné par rapport à la raison d’être de ce blog et de tous mes projets connexes. Je vais la rajouter à mon Ikigai:
Je t’aide à respirer financièrement à chaque fin de mois, pour que tu puisses t’investir là où ça a du sens.
Plus de clarté dans mon paradoxe de la vie de rentier
Pour devenir rentier, tu dois bosser. On n’a rien sans rien. Et une fois indépendant financièrement (= rentier = FIRE), tu continues de contribuer à faire tourner le monde en mettant ton capital à disposition. C’est aussi une forme de contribution.
Résumé par Jean-Pierre Danthine: “il n’y a pas que le travail, il y a aussi le capital, les moyens financiers.”
Ou comment avoir plus de clarté sur beaucoup de mes paradoxes humains.
Je remercie encore énormément M. Danthine de m’avoir accordé de son temps si précieux, lui qui bosse à fond sur la fin du monde :)
Et toi, tu retiens quoi de cette interview? (comme d’habitude en mode constructif et apolitique s’il te plaît)

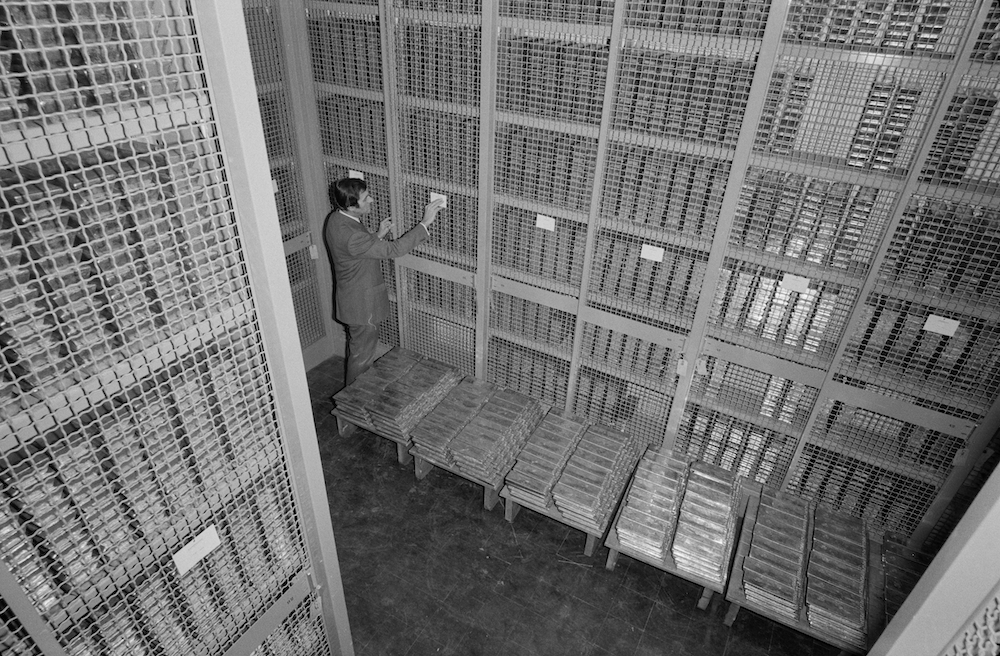





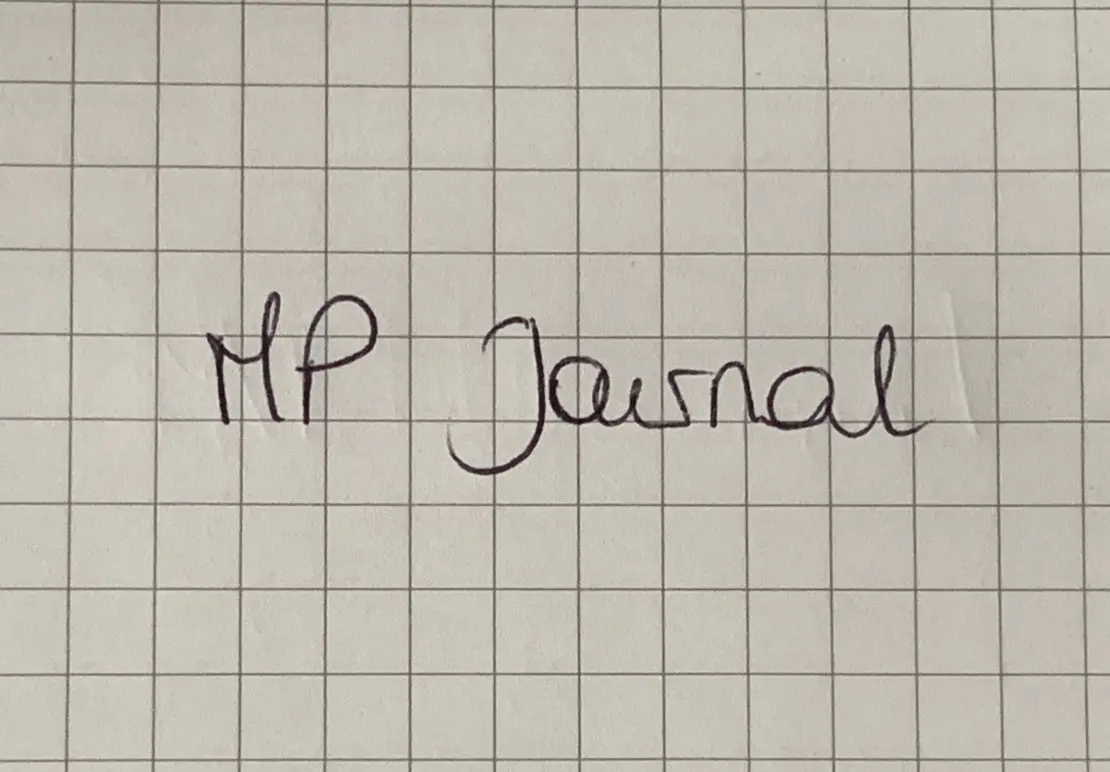
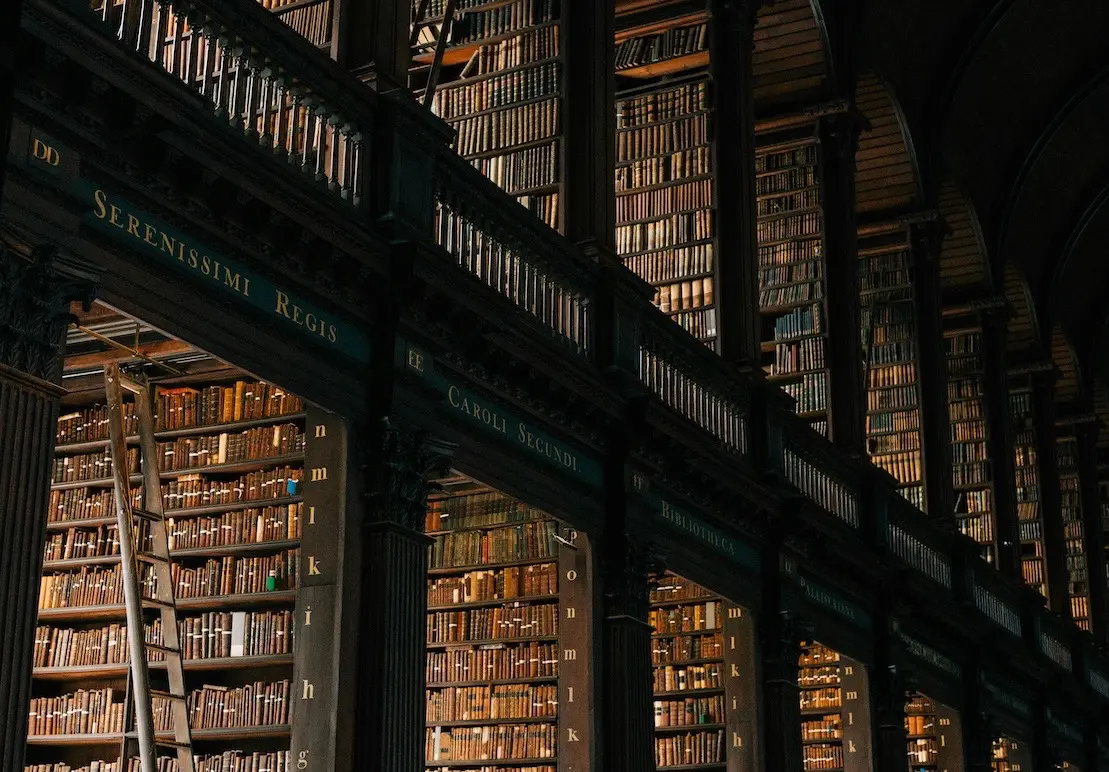
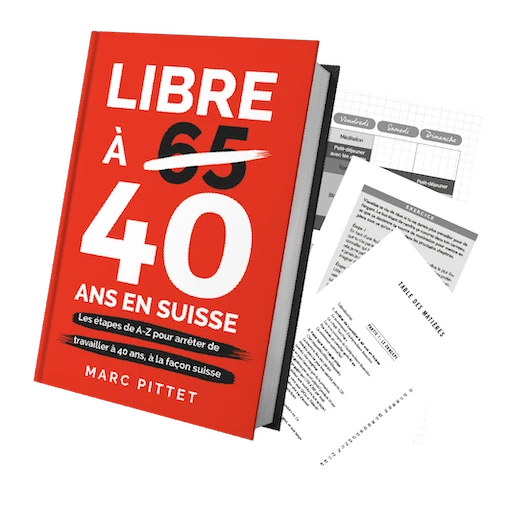
Dernière mise à jour: 3 juillet 2025